Trastevere - Lungara et Janicule (16/20). La Fontaine de l'acqua Paola et le belvédère sur Rome.
Erection de la fontaine et pillage des ruines romaines
/image%2F1313864%2F20240421%2Fob_0d1b04_trastevere-janicule-vue-generale-05.JPG)
« Mais, voici, elle arrive à la fin de son chemin, et d’ici quelques pas, elle sera parvenue à sa première embouchure : elle jaillira en torrents des trois bouches de la grande fontaine du Janicule, en vue de Rome entière, aux fontaines du Ponte Sisto, de la via Giulia, de la piazza Farnese, du campo dei Fiori, de la piazza Navona, jusqu’à ce grand décor de pierre qu’est la fontana di Trevi ; partout elle portera son flot vocal, qui vient animer les architectures »[1]
En 1608, le Pape Paul V Borghèse (1605 / 1621) fit restaurer l’aqueduc romain Aqua Traiana, construit par l'empereur Marco Ulpio Traiano en 109, dans l’objectif d'alimenter en eau les quartiers du Borgo, du Vatican, du Trastevere et de la Via Giulia. L’aqueduc, long de 32 km, reçoit les eaux provenant des lacs de Bracciano, Oriolo Romano et Trevignano. Ses points d'arrivée sont la fontaine Trilussa (piazza Trilussa) et la fontaine Paola. Celle-ci fut érigée en 1610 / 1614 par les architectes Flaminio Ponzo et Giovanni Fontana, avec des éléments prélevés du forum romain et du temple de Minerve sur le forum de Nerva[2] . En forme d'arc de triomphe à trois grandes niches centrales, flanquées de deux plus petites, elle s’ouvre vers la ville comme une scène de théâtre. Devant les pieddroits, six colonnes de granit séparent les cinq niches et supportent un très volumineux entablementsurmonté d'un attique, avec les armes de Paul V, de la famille Borghèse, représentant un aigle couronné aux ailes déployées et un dragon ailé : « D'azur au dragon d'or au chef d'or à l'aigle de sable couronné d'or ».
« Hier soir, chez Mme de D***, nous avons vu plusieurs gravures représentant ce monument (le temple de Pallas) tel qu’il était avant Paul V. Ce pape le fit démolir parce qu’il avait besoin des marbres pour sa fontaine Pauline sur le mont Janicule. L’utilité du livre que vous lisez, si tant est qu’il en ait, est peut-être d’empêcher à l’avenir de tels attentats » [3].
De la fontaine Paola, vous aurez aussi une des plus belles vues sur Rome. C’est de là que Zola fait commencer son roman « Rome ». Son personnage principal, Pierre Froment, un jeune prêtre français à la foi ébranlée, vient à Rome pour y défendre, auprès de la congrégation de l’Index, son livre dans lequel il plaide pour un renouveau du catholicisme allié au mouvement démocratique et social[4]. Arrivé le matin de Paris par le train, il se fait conduire sur le Janicule pour y admirer la ville.
« Ici, tout près, il reconnaissait à sa loggia tournée vers le fleuve, l’énorme cuve fauve du palais Farnèse. Plus loin, cette coupole basse, à peine visible, devait être celle du Panthéon. Puis, par sauts brusques, c’étaient les murs reblanchis de Saint-Paul-hors-les-Murs, pareils à ceux d’une grange colossale, les statues qui couronnent Saint-Jean-de-Latran, légères, à peine grosses comme des insectes ; puis, le pullulement des dômes, celui du Gesù, celui de Saint-Charles, celui de Saint-André-de-la-vallée, celui de Saint-Jean-des-Florentins ; puis, tant d’autres édifices encore, resplendissants de souvenirs, le Château Saint-Ange dont la statue étincelait, la villa Médicis qui dominait la ville entière, la terrasse du Pincio où blanchissaient des marbres parmi des arbres rares, les grands ombrages de la villa Borghèse, au loin, fermant l’horizon de leurs cimes vertes ».
Vers la porte San Pancrazio, la Villa Aurelia est située sur le point culminant du Janicule. Elle a été construite pour Girolamo Farnese, vers 1650, quand il a assumé la charge de gouverneur de Rome. La villa a connu ensuite des fortunes diverses, de très nombreuses modifications et appartient à l'Académie américaine de Rome depuis 1909. Restaurée en 2002 sur les bases de la documentation sur sa situation au XIXe siècle, elle accueille des concerts, des conférences et des événements culturels de l'Académie et des initiatives privées.
[1] Giogio Vigolo. « La Virgilia ». 1982.
[2] Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. « Mostra dell’Acqua Paola al Gianicolo ». Sur réservation, pour des groupes culturels et des associations, il est possible d'accéder au jardin situé derrière (max 25 personnes) que le pape Alexandre VII Chigi (1655 / 1667) avait destiné à être un jardin botanique.
[3] Stendhal. « Promenades dans Rome ». 1829.
[4] Ce sera évidemment un cause perdue. Emile Zola. « Rome ». 1896.


/image%2F1313864%2F20240418%2Fob_df83a8_trastevere-janicule-monument-aux-morts.JPG)
/image%2F1313864%2F20240418%2Fob_c38677_trastevere-janicule-tempietto-4.JPG)
/image%2F1313864%2F20240411%2Fob_e0bd7a_trastevere-janicule-san-pietro-in-mont.jpg)
/image%2F1313864%2F20240411%2Fob_0f3aa0_trastevere-janicule-via-di-porta-san-p.jpg)
/image%2F1313864%2F20240410%2Fob_0dec37_trastevere-janicule-jardins-d-arcadie.JPG)
/image%2F1313864%2F20240409%2Fob_4591f5_trastevere-janicule-via-garibaldi-sai.JPG)
/image%2F1313864%2F20240406%2Fob_4397f4_trastevere-lungara-porta-settimiana.jpg)
/image%2F1313864%2F20240406%2Fob_9f5545_fondation-torlonia.jpg)
/image%2F1313864%2F20240325%2Fob_e8746f_trastevere-lungara-farnesina-2.jpg)
/image%2F1313864%2F20240326%2Fob_ebf9ca_trastevere-lungara-galerie-corsini-2.JPG)
/image%2F1313864%2F20240325%2Fob_37760f_trastevere-lungara-galerie-corsini-1.JPG)
/image%2F1313864%2F20240325%2Fob_3b9d75_rome-trastevere-lungara-san-giacomo-al.jpg)
/image%2F1313864%2F20240325%2Fob_816339_trastevere-lungara-prison-regina-coel.JPG)
/image%2F1313864%2F20240315%2Fob_a8bc9c_rome-trastevere-rives-du-tibre-collect.jpg)
/image%2F1313864%2F20240315%2Fob_dd7d20_rione-trastevere-janicule.jpeg)
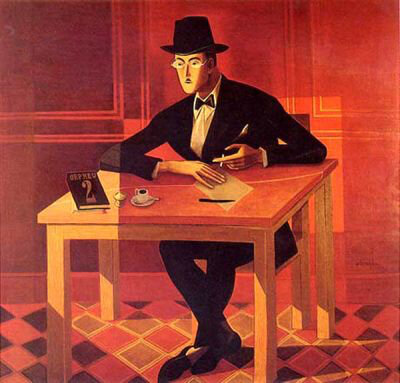
/image%2F1313864%2F20240309%2Fob_b56e73_portugal-lisbonne-alfama.jpg)
/image%2F1313864%2F20240309%2Fob_12540f_portugal-lisbonne-afalma-vue-general.jpg)
/image%2F1313864%2F20240309%2Fob_269525_portugal-lisbonne-monastere-des-joron.jpg)
/image%2F1313864%2F20240320%2Fob_dd4869_borgo-spina-di-borgo-av-1900.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F21%2F45%2F1136176%2F134483669_o.png)